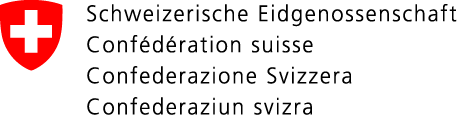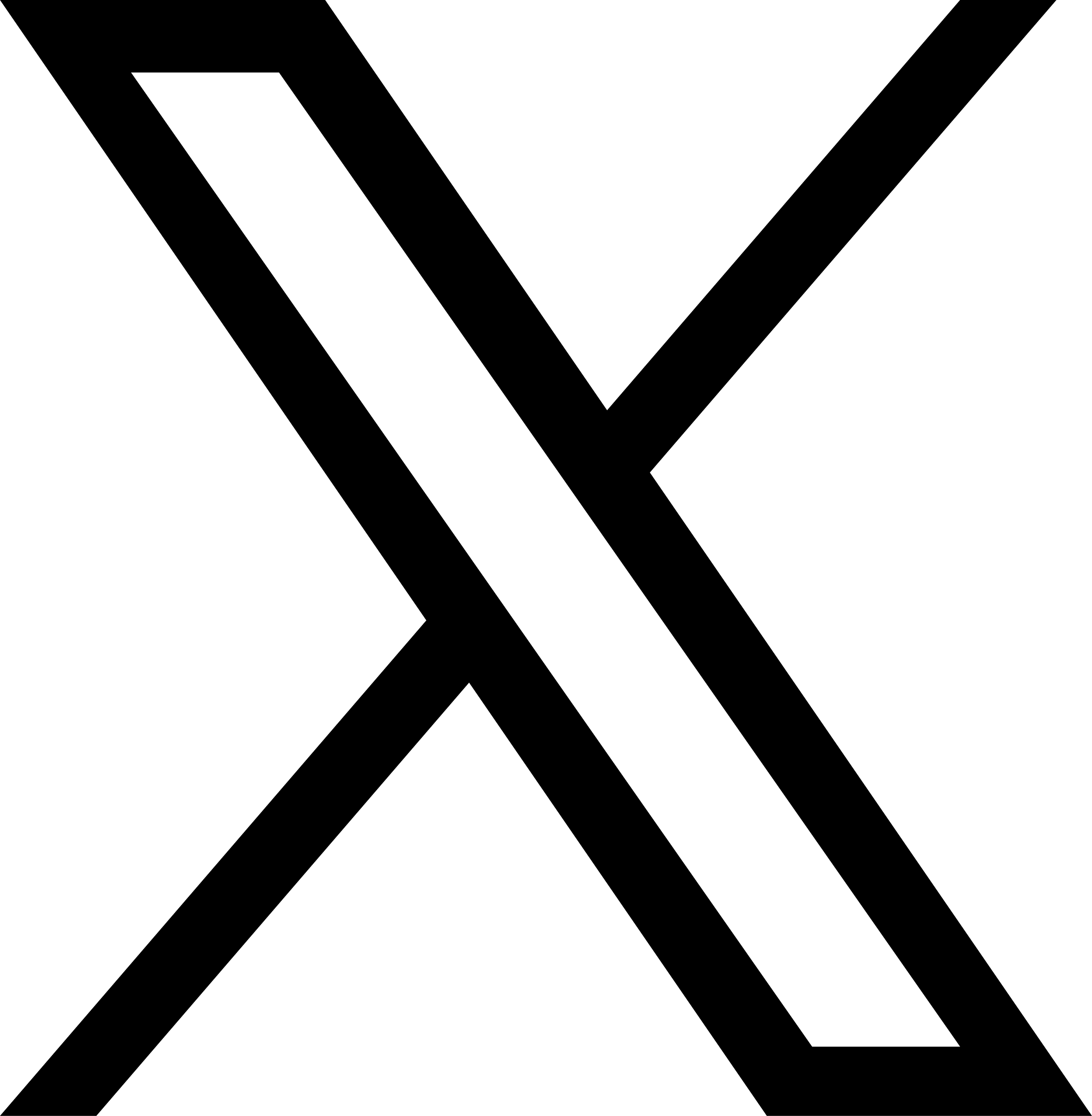Pourquoi nous lisons
car nous avons trop lu avant
sous nos couvertures d’enfant
pour souscrire au néant
car nous avons appris
qu’en ces pages de nuit
se rejouait la vie
et que les heures de cendre
à fuguer et comprendre
abreuvaient nos méandres
oui nous savons désormais
que les vieux alphabets
tracés à la craie
sur l’ardoise des certitudes
finiront comme d’habitude
par dire leur incomplétude
oui nous lisons
nos yeux comme des tisons
dans la forêt sans nom
où trébuchent les saisons
où s’écroulent comme la raison
les damnés de la migration
car nous ne sommes pas indifférents
à la colère des perdants
au sacrilège du vivant
car nous respirons ensemble
malgré le sol de Blatten qui tremble
quand tout se désassemble
car nous sentons aussi
la fumée des incendies
et le souffle des meurtris
car nous cherchons affamés
un monde à partager
un territoire à habiter
car nos regards sur le passé
ne seront jamais assez
désensablés
car nos regards sur le présent
ont besoin dorénavant
d’embrasser l’ouvert du temps
oui nous lisons à contretemps
car tout a été dit sûrement
mais personne n’entend
car les Grands Récits n’ont plus cours
et chacun sait qu’aucun discours
n’épuisera jamais le jour
car nous cherchons sans fin nos mots
ceux qui nous font défaut
quand s’exclament les bourreaux
car la beauté s’est absentée
et qu’elle nous manque en nos chantiers
maçonnés de vérités
car nous voyons quelle violence
les voix épuisées dispensent
sous l’épée du silence
–
voilà pourquoi nous lisons
debout dans la démolition
de l’horizon
pour que surgisse de l’inconnu
le chant des peines irrésolues
et le grand cri des joies vécues
pour qu’éclatent enfin
en dissonances diluviennes
la voix des écrivain·e·s
voilà pourquoi nous avons lu
180 textes dont sept élus
qui nous ont souvenu
que la littérature profonde
était cette langue seconde
proclamant loin à la ronde
oui, je suis sensible au monde
oui, tu es sensible au monde
oui, nous sommes sensibles au monde
Thierry Raboud