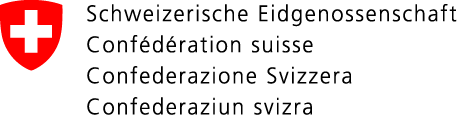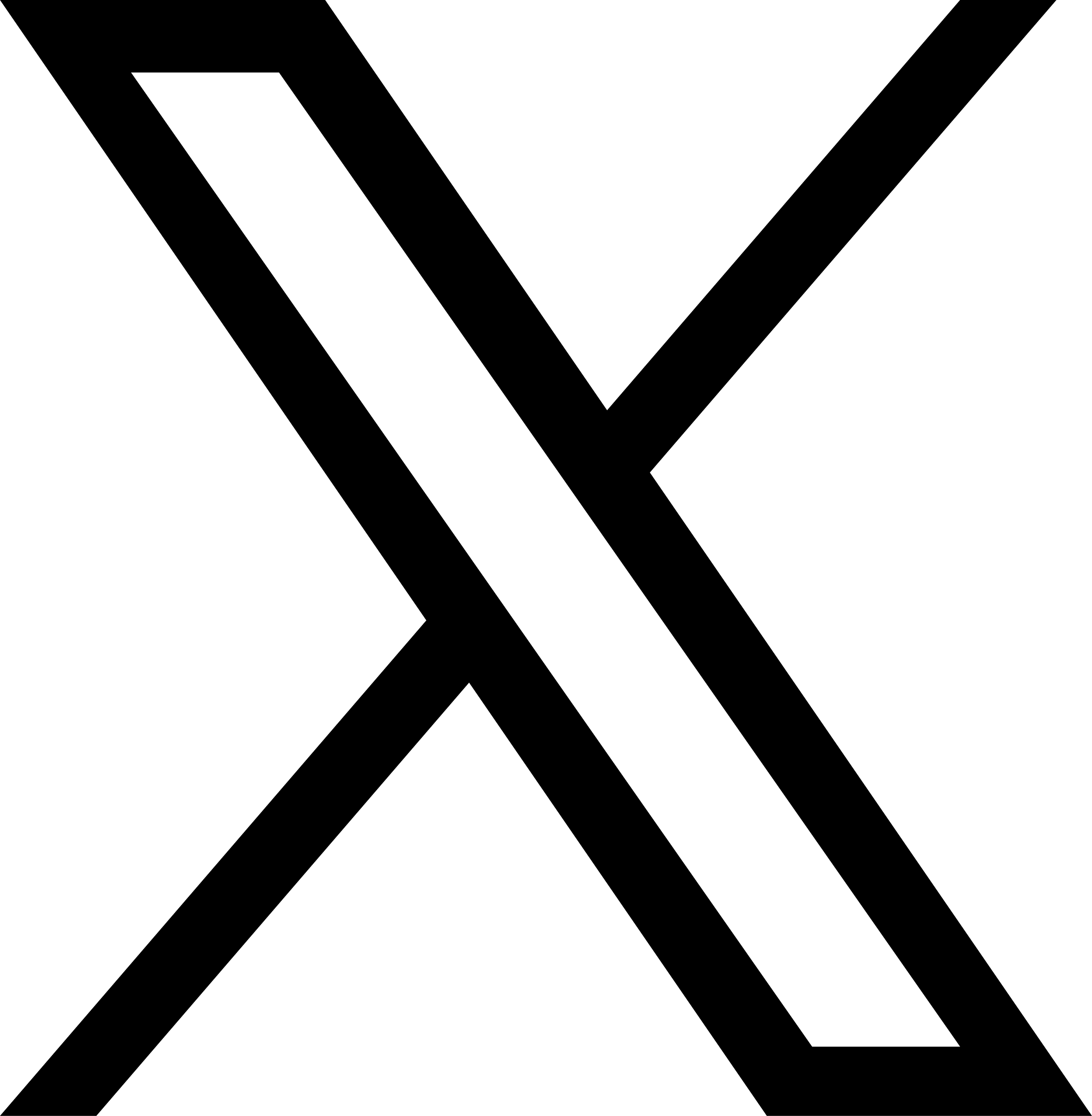Introspection et densité du langage sont deux caractéristiques de l’œuvre de Klaus Merz. L’auteur argovien ici récompensé est une voix qui n’a rien de tonitruant, mais qui est d’autant plus persuasive et marquante, et qui se fait entendre bien au-delà des frontières suisses. Depuis son premier recueil de poèmes, Mit gesammelter Blindheit (1967), il a composé en plus de cinquante ans une œuvre aux multiples facettes : poésie, prose (récits, nouvelles, romans brefs et essais), pièces de théâtre, pièces radiophoniques et livres pour enfants. Ce sont près de trente livres, déjà réunis dans une édition complète de son œuvre, et pourtant cette œuvre continue de croître, de tâtonner délicatement comme si elle tendait ses antennes dans des directions sans cesse renouvelées : vers la vie intime d’une entreprise du plateau suisse (firma, 2019), ou sur les traces lumineuses du souvenir (Noch Licht im Haus, 2023).
Klaus Merz pratique une littérature à ancrage régional qui ouvre sur l’universel. Né dans le Wynental, en Argovie, l’auteur y a grandi et y vit encore aujourd’hui. Mais ses personnages essaiment, ses textes sont peuplés de figures qui émigrent, tentent de rompre avec la société ou reviennent au pays, comme le grand-père dans la nouvelle L’Argentin (2009), qui, de retour en Suisse, reconstruit un « nouveau » monde à lui en tant que maître d’école. Cette dimension universelle de son œuvre se révèle aussi dans la multitude de ses traductions : en français, en italien, en anglais et en espagnol, ou encore en russe et en persan.
Voir ! Tel est le postulat qui depuis des années guide la quête littéraire de Klaus Merz. C’est un mouvement qui tâtonne vers le dedans comme vers le dehors, et en même temps une attente patiente, jusqu’à ce que les images s’impriment d’elles-mêmes sur la rétine et se fixent sous forme de souvenirs. En ce sens, on peut qualifier de « visions » non seulement les nombreux poèmes et essais consacrés aux arts plastiques et à la photographie (Das Gedächtnis der Bilder, 2014), mais aussi tous ses autres textes. Les poèmes s’écrivent lentement, certains sur des années, en éliminant le moindre mot qui ne soit pas d’une nécessité absolue. C’est un processus de réduction progressive dans lequel, au final, le fait de ne pas écrire s’impose comme « un acte d’écriture par excellence ». « Un texte doit avoir longtemps maturé » – fidèle à ce credo, Klaus Merz prend tout son temps, et laisse le vécu décanter jusqu’à ce qu’il se transforme lentement en littérature. Ne subsiste alors que l’essence. Comme dans son chef-d’œuvre, le bref roman Frère Jacques (1997), qui a valu à Klaus Merz une reconnaissance internationale. Cette histoire familiale parle de maladie, de meurtrissure et de mort, mais chante aussi la vie et les liens entre les êtres humains. Si la maladie et la mort sont des leitmotivs de son œuvre, cette dernière est néanmoins tissée de gaieté lumineuse, de profondeur comme suspendue, et toujours soucieuse de faire émerger le « matériau latent » qui sommeille sous la surface du quotidien. Un programme poétique annoncé par le poème « Voies royales » : « Remontant la rivière / les saumons retournent / vers leurs frayères. // Dans le courant de la langue / le poème bâtit / un escalier / au mot. »